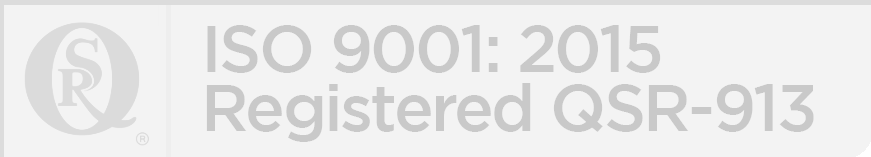La science (et l’histoire) derrière les vêtements imperméables
septembre 1, 2025
Catégorie: Activités extérieures, Équipement de plein air, Randonnée
Se protéger de la pluie et rester au sec ont toujours été un défi universel pour l’humanité. Les peuples indigènes d’Amérique centrale ont été les premiers à imperméabiliser les vêtements, en utilisant la sève extraite des arbres à caoutchouc, une technique rapidement adoptée par les conquistadors après leur arrivée. Mais le caoutchouc brut était loin d’être idéal : il se raidissait au froid et devenait collant sous la chaleur. Pendant des siècles, des tissus fortement huilés, souvent malodorants, sont devenus la solution standard pour les marins et les explorateurs.
Ce n’est qu’au 19e siècle, en 1823, que Charles Macintosh (oui, l’homme derrière le manteau mac) a intercalé une couche de caoutchouc entre deux couches de tissu tissé, marquant un bond en avant majeur dans la technologie de l’imperméabilisation. Deux décennies plus tard, le processus de vulcanisation (ajout de soufre au latex) a stabilisé le caoutchouc, et la technologie Macintosh est restée pratiquement inchangée depuis.
Malheureusement, les vêtements imperméabilisés au caoutchouc présentent deux inconvénients majeurs : ils sont lourds et totalement non respirants. Aucune de ces situations n’était un problème pour les chasseurs indigènes Yup’ik de la région polaire. En utilisant les membranes intestinales obtenues à partir de mammifères marins, ils ont créé la première protection extra-légère et respirante au monde contre l’humidité, bien avant que les membranes synthétiques ne soient même une option. Pourtant, cette ingénieuse technologie arctique est restée liée à son lieu d’origine, sans jamais se propager dans le monde entier.
Depuis son invention en 1938, le polytétrafluoroéthylène a trouvé des applications dans tout, des vêtements imperméables aux poêles antiadhésives. Cependant, sous sa forme brute, il n’était pas plus respirant que le caoutchouc, ne laissant pas d’autre choix que de transpirer sous la pluie. Cela a changé avec la découverte accidentelle du Gore-Tex, une structure microporeuse légère, respirante et, surtout, imperméable. Aujourd’hui, le Gore-Tex est fabriqué à partir d’un composé légèrement modifié, mais sa conception fondamentale reste la même : une membrane prise en sandwich entre des couches de tissu protecteur. Pour améliorer encore les performances, la plupart des vêtements reçoivent également un traitement : DWR (répulsif à l’eau durable) revêtement sur la surface extérieure.
Les imperméables d’aujourd’hui se déclinent dans une multitude de designs adaptés à des applications très différentes : des vestes ultralégères et minimalistes aux coques rigides isolées. Pour une utilisation prolongée dans des conditions difficiles et humides, la combinaison d’une membrane imperméable et d’une isolation synthétique est le meilleur choix. Des marques telles qu’Arc’teryx, Eddie Bauer et Mountain Equipment choisissent l’isolation à filament continu Climashield®, qui fonctionne même lorsqu’elle est mouillée, au cas où la membrane est défectueuse, chose improbable.
Le plus souvent, lorsque le traitement DWR s’use, l’humidité sature le tissu extérieur d’un vêtement, ce qui entraîne une baisse drastique de sa respirabilité. À mesure que la chaleur et la sueur s’accumulent à l’intérieur, le porteur peut finir par avoir froid et ressentir l’humidité. Même dans ce scénario, l’isolation synthétique offre une protection : elle conserve son volume lorsqu’elle est mouillée, grâce à la technologie propriétaire Technologie AquaBan Climashield® qui continue de fournir de la chaleur dans toutes les conditions.
Bien que les vestes imperméables d’aujourd’hui combinent des membranes de pointe avec une isolation synthétique avancée, leur but est resté le même depuis des millénaires. Rester au chaud et au sec a permis l’émergence de cultures, alimenté l’exploration et continue de nous garder en sécurité et heureux dans la grande nature, quelles que soient les conditions météorologiques.